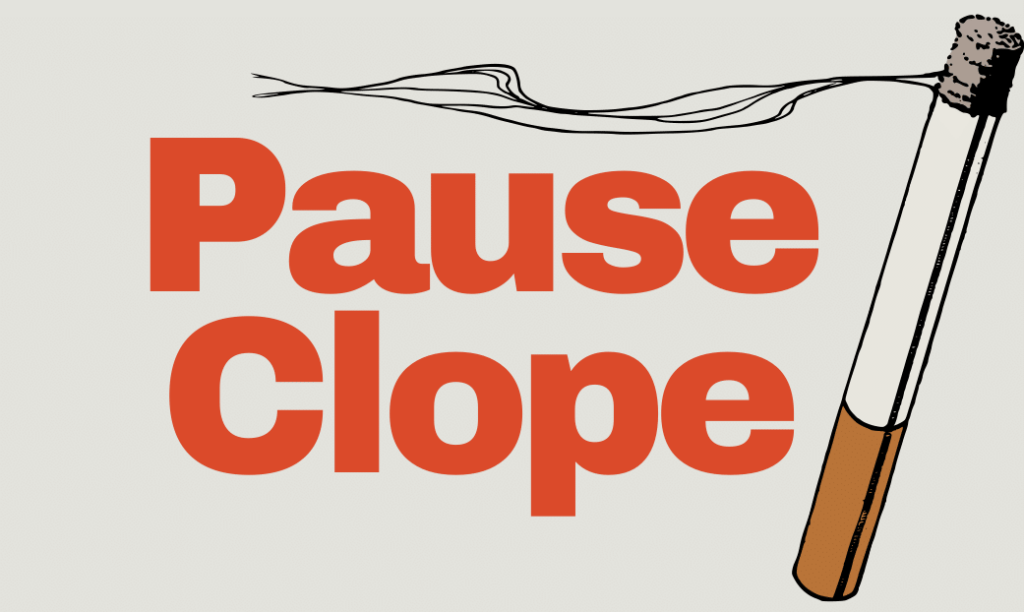Une surpopulation carcérale sans précédent
Le constat est sans appel : la surpopulation des prisons en France atteint des sommets. Au 1er septembre 2024, le nombre de personnes détenues s’est élevé à près de 79 000 pour seulement 62 000 places opérationnelles, soit un taux d’occupation moyen de 127,3 %. Plus encore, dans certains établissements, ce chiffre dépasse les 200 %, obligeant quelques 3 600 prisonniers à dormir sur des matelas posés au sol.
Toujours est-il que cette situation n’est pas nouvelle. Elle a mené la Cour européenne des droits de l’homme à condamner la France en 2020, dénonçant ainsi des conditions de détention inhumaines et dégradantes. En effet, derrière ces chiffres se cache une réalité brutale. Bâtiments obsolètes, réseaux électriques défaillants, fenêtres non étanches, humidité omniprésente, prolifération de rats et punaises : le quotidien des personnes incarcérées se dégrade continuellement. Les conséquences ? Une véritable montée des tensions, des violences accrues, mais surtout une impossibilité de facto à participer aux activités éducatives ou professionnelles pourtant censées les préparer à une vie hors les murs. La priorité n’est plus à l’accompagnement. Le temps passé en détention est souvent peu ou mal utilisé pour préparer à une vie libre et autonome. Faute de moyens et d’espace, les activités professionnelles ou éducatives sont rares, privant les personnes détenues d’une véritable opportunité de réhabilitation.
La promesse insuffisante de nouvelles places de détention
Face à ce désastre, les réponses politiques semblent répétitives mais surtout limitées. Si l’ancien chef du gouvernement, Michel Barnier, a promis « plus de places de prison » lors de sa déclaration de politique générale du 1er octobre dernier, il ne s’agit là que d’un prolongement du « plan 15 000 » annoncé en 2021 par Éric Dupond-Moretti, visant à créer davantage d’espaces carcéraux. Ces annonces peinent à convaincre. Si le nombre de places de prison a doublé depuis trente ans, cela n’a pas freiné l’augmentation continue de la population carcérale, qui reste une problématique systémique de la justice française.
Comme le rappelle la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simonnot, la surpopulation carcérale nécessite une véritable politique publique axée sur des alternatives à l’incarcération et des aménagements de peine plus adaptés. En effet, augmenter la capacité des prisons ne fait qu’accompagner la hausse des incarcérations sans en résoudre les causes structurelles. Les experts appellent à une refonte complète de la politique pénale, axée sur un recours accru aux alternatives à l’enfermement déjà prévus par la loi tels que le travail d’intérêt général ou les placements sous surveillance électronique. Autrement dit, le problème n’est pas l’application de la peine de prison en elle-même mais bien son prononcé, peut être trop automatique.
La réinsertion : cet objectif oublié
Le passage en prison ne se résume pas à l’enfermement. Il a aussi pour mission de préparer les personnes détenues à leur réinsertion dans la société. Or, dans des conditions aussi dégradées, cet objectif se trouve largement compromis.
La réinsertion commence dès la détention, par des démarches administratives essentielles telles que le renouvellent des papiers d’identité. Des services comme les SPIP (Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation) ou des associations telles que le Mouvement pour la Réinsertion Sociale jouent un rôle clé dans cet accompagnement. Par exemple, à la maison d’arrêt de Fresnes, des dispositifs permettent aux personnes détenues de se domicilier administrativement auprès d’une boîte aux lettres, facilitant ainsi les démarches postales. Les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation sont les premiers interlocuteurs facilitant ces démarches. Ils interviennent au sein même de l’établissement pénitentiaire pour accompagner un détenu.
Pourtant, ces initiatives restent limitées face à l’ampleur des besoins. Faute de moyens suffisamment, l’action des organismes de réinsertion est réduite. Chaque année, près de 69 000 personnes détenues retrouvent la liberté. Parmi elles, 30 % n’ont ni argent, ni emploi, ni logement. Plus encore, un détenu sur cinq sort avec moins de 8 euros en poche. Comment imaginer un avenir avec si peu de moyens ? Le soir de leur libération, beaucoup ignorent où dormir, faute de famille ou d’amis prêts à les accueillir.
Cette précarité immédiate est souvent le prélude à une récidive. Selon les dernières données, 60 % des anciens détenus ont de nouveau affaire à la justice dans les cinq ans suivant leur libération, et près de 40 % retournent en prison.
« La prison détruit »
L’entrée en prison est un traumatisme, souvent décrit comme un « choc carcéral » : l’enfermement dans des espaces bruyants, insalubres, et surpeuplés bouleverse les repères. On parle pourtant moins du choc inverse, celui de la sortie.
Recouvrer la liberté peut être tout aussi brutal que de la perdre. Les anciens détenus doivent se réhabituer à des gestes simples : franchir une porte sans demander d’autorisation, monter dans un bus, ou même supporter le bruit des enfants. Après des années d’enfermement, la vie en liberté s’avère effrayante. La prison bouleverse tout et il faut apprendre à se reconstruire sur ce qui reste. Ces hommes et ces femmes portent à vie les stigmates de leur incarcération, souvent perçus comme des parias dans une société qui les rejette.
Interrogée par notre journaliste, Maître Sivane Seniak, avocate au barreau du Val de Marne est du même avis. Elle explique que « la prison détruit, elle permet simplement d’éloigner le danger pendant un certain temps mais elle ne prépare rien, qui plus est l’état de nos prisons est catastrophique ».
Son parcours professionnel lui permet d’affirmer qu’il n’y a jamais un même dossier, un même contexte, une même histoire ni même un même parcours. Ce constat étant fait, la prise en charge des détenus se doit d’être individualisé selon la personnalité de l’agresseur et son positionnement à l’égard des faits.
Maître Seniak déplore des conditions carcérales mauvaises ne permettant pas une prise en charge adaptée, notamment sur les plans physiques et psychologiques. Si l’avocat arrive à faire en sorte que la personne détenue voit un psychologue à hauteur d’une fois par mois, « c’est déjà énorme » dit-elle. L’état du système médical carcéral, particulièrement en psychiatrie, est regrettable et empêche tout travail de récidive.
Elle conclut en résumant que les incarcérations qui vont porter leurs fruits sont extrêmement marginales. Dès lors, c’est un chantier considérable car penser l’accompagnement des auteurs d’infractions est tout aussi important que de penser l’accompagnement des victimes.
Vers une politique pénale plus humaine ?
La crise des prisons françaises met en lumière un double échec : celui d’un système pénal qui privilégie l’enfermement massif et celui d’une société qui ne sait pas accueillir les anciens détenus.
La prison, bien plus qu’un lieu de sanction, doit redevenir un espace de transformation. Si la justice française veut réduire la récidive et favoriser la réinsertion, elle doit envisager l’incarcération non comme une fin en soi, mais comme un outil de réinsertion. Faute de quoi, les mêmes erreurs se reproduiront, et le cycle de la récidive continuera de s’aggraver.
Mathilde LEMAIRE