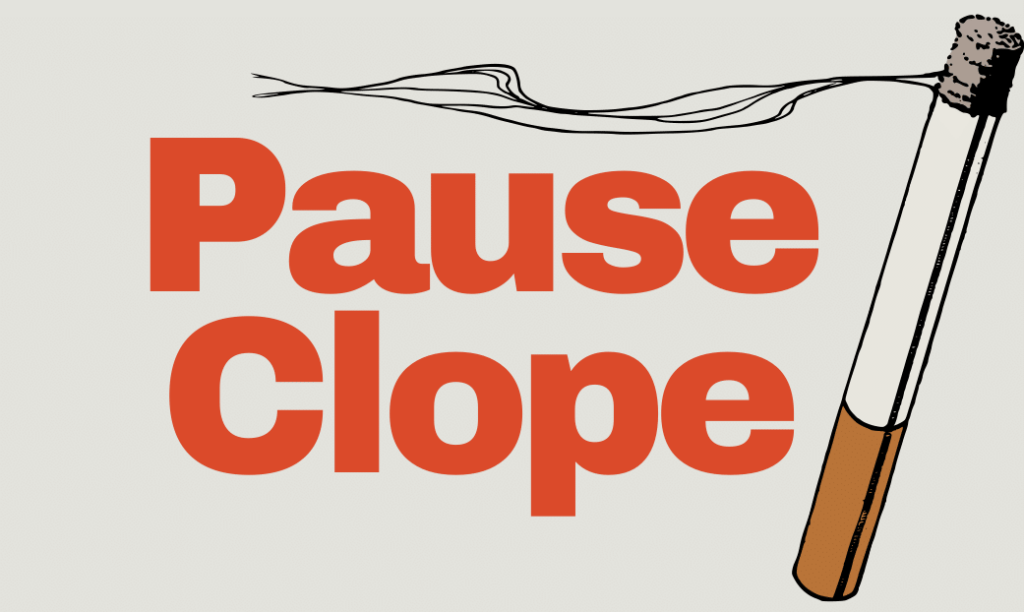En 2000, la France était le deuxième exportateur mondial de produits agricoles. 20 ans plus tard, l’agriculture française a chuté de trois places. Forcément, la baisse d’exportations s’est compensée par une multiplication par deux des importations sur le territoire.
Depuis deux semaines, les agriculteurs manifestent à nouveau pour éviter que les importations continuent d’augmenter. L’accord UE-Mercosur, s’il est adopté, permettra à l’Argentine, le Brésil et d’autres pays d’Amérique du Sud d’importer sans frais de douanes « des poulets dopés aux antibiotiques, du maïs traité à l’atrazine ou du boeuf responsable de la déforestation », résument les sénateurs français dans une résolution adoptée le 16 janvier dernier. « Pour qu’une viande bovine soit rentable, il faut que je la vende six euros le kilo. Ca ne serait pas tenable de nous imposer l’arrivée de viandes à deux euros le kilo », se désole Stéphane Charbonneau, éleveur de bovins en Vendée. En échange de ces produits agricoles, les pays européens pourront importer des métaux rares ou exporter des voitures à moindre frais.
Le gouvernement français, farouchement opposé au texte, tente de faire pression au niveau européen. En plus des sénateurs, il est appuyé par plus de 600 parlementaires français qui se sont opposés au texte dans une tribune dans le Monde. Mais avec pour l’instant comme seuls soutiens l’Autriche, l’Irlande, les Pays-Bas et la Pologne, l’opposition européenne au contrat est bien loin des 15 États représentant 65% de la population de l’UE nécessaires à son retrait.
Ils souffrent aussi du libre échange européen
Mais le Mercosur n’est qu’un nouveau fardeau à ajouter au sac des agriculteurs. Cause historique de leur grondement, la Politique agricole commune (PAC). Mise en place en 1962, c’est l’une des plus anciennes politiques européennes. Depuis sa création, elle représente près d’un tiers du budget européen (386,6 milliards d’euros pour 2021-2027) et vise à « garantir la sécurité alimentaire » : elle assure un revenu minimum aux agriculteurs et ouvre à la libre circulation les produits agricoles sur le territoire des États-membres.
Quand le premier volet est assez rarement critiqué (il représente 22% des revenus des agriculteurs français), le deuxième, quant à lui, est perçu comme de la concurrence déloyale. Si la PAC inclut des normes environnementales et éthiques, elles ne sont pas aussi ambitieuses que celles mises en place en France. Cela signifie que d’autres pays européens peuvent mettre en vente des fruits ou des légumes moins chers et moins réglementés. En avril dernier, les fraises en avaient fait les frais : les françaises, Gariguettes en tête, étaient vendues autour de 15 euros le kilo, contre seulement 5 à 6 euros pour les espagnoles ou 4 euros pour les italiennes.